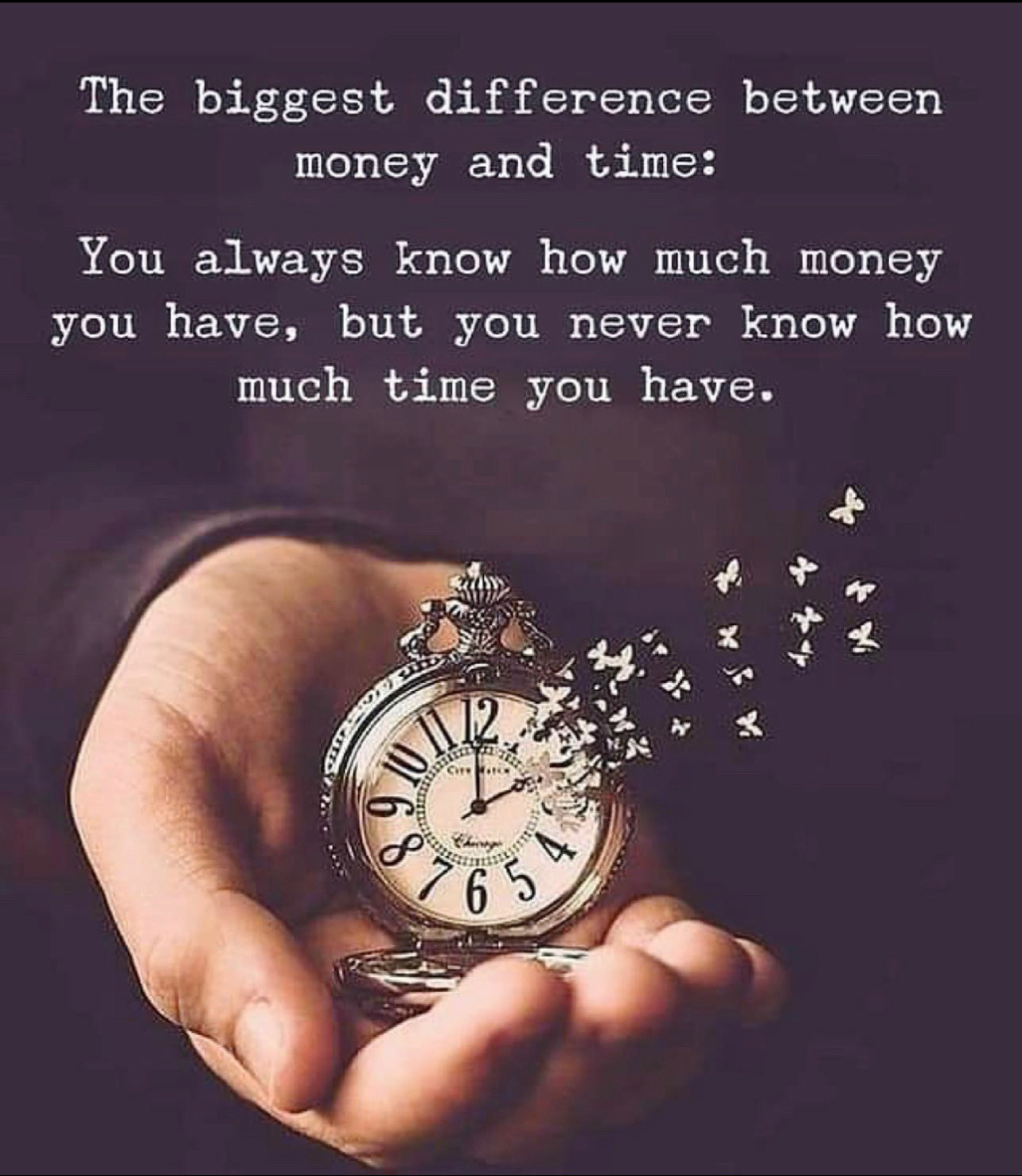Publié dans Télérama le 21/8/2019 – Par Olivier Tesquet
Technicien visionnaire, champion d’un esprit d’entreprise “cool” mais dévorant… Mark Zuckerberg ? Steve Jobs ? Non, Robert Noyce, l’ingénieur qui a fait de la Silicon Valley le centre du monde.
A force de se fondre dans le décor, penché sur un bureau en métal plus spartiate encore que celui de ses sténographes, Robert Noyce avait fini par devenir invisible. Mais le propre de n’être nulle part, c’est d’être partout. Entre deux places de parking, au 844 East Charleston Road, à Palo Alto, à quelques kilomètres de l’université de Stanford, une plaque installée par le département des parcs et loisirs de Californie vient rappeler l’importance capitale du scientifique dans le développement – ou plutôt l’explosion – de la Silicon Valley. Mort en 1990, Robert Noyce continue de charger l’air de celle-ci, où des cohortes d’inventeurs obsessionnels et pas toujours rassurants conçoivent le monde de demain depuis plus d’un demi-siècle.
Leur point commun ? Tous, ou presque, sont ses disciples. Selon une étude du think tank Endeavor réalisée en 2014, 70 % des entreprises de la région sont liées à sa propre aventure. Deux mille sociétés. Huit cent mille personnes. Une grande famille recomposée dont Bob Noyce est le patriarche. « Le maire de la Silicon Valley », comme on le surnommait, aura régné aussi longtemps qu’un Edouard Herriot ou un Jacques Chaban-Delmas.

Né en 1927 à Burlington, dans le talon de l’Iowa, à quatre heures de route de Chicago, Noyce est un enfant du Midwest. Troisième d’une fratrie de quatre garçons, il est le fils et le petit-fils de clercs congrégationalistes, ces protestants qui ont quitté la Nouvelle-Angleterre pour gagner le cœur des Etats-Unis au milieu du XIXe siècle et y construire des villes en même temps qu’un modèle de société. Elève au Grinnell College (comme un certain Gary Cooper), une faculté de renom qui n’a pas grand-chose à envier aux prestigieux campus de la côte est, il s’y distingue par des prédispositions naturelles pour la physique et la natation.
Une sombre histoire de barbecue
Brillant étudiant, athlète accompli, il souffre aussi d’un syndrome classique chez les adolescents qui se sentent à l’étroit : un goût immodéré pour les conneries. En 1948, afin de satisfaire une envie de luau, ce festin hawaïen composé notamment de cochon rôti, populaire dans l’Amérique de l’après-guerre, il s’introduit sur les terres d’un paysan du coin pour lui soustraire un porc. Le lendemain, il retourne s’excuser auprès du fermier, mais celui-ci avertit le shérif et saisit la justice. Il faut toute la diplomatie d’un de ses professeurs pour lui éviter les poursuites.
L’avenir de l’informatique tient-il à une sombre histoire de barbecue sauvage ? A son retour au Grinnell College, après six mois d’exclusion et un stage à New York, Noyce se prend de passion pour une toute nouvelle invention : le transistor, cet interrupteur qui permet de moduler les oscillations électriques. Grant Gale, le prof de physique qui l’a sorti du pétrin, en a obtenu deux exemplaires grâce à ses bonnes relations avec un ancien camarade de classe, John Bardeen, futur double Prix Nobel de physique et co-inventeur dudit transistor.
A l’époque, cet assemblage d’électrodes est encore très loin d’être le composant essentiel de n’importe quel appareil électronique. Au milieu des années 1950, le seul débouché qui s’offre à cette trouvaille se niche dans les radios, qu’on en vient à appeler transistors par métonymie. Quand il part pour le Massachusetts Institute of Technology (MIT), le jeune Noyce se heurte à un mur d’incompréhension. Il est trop en avance. Après avoir obtenu son doctorat de physique en 1953, il est embauché par Philco, l’un des leaders de la production de batteries, basé à Philadelphie. Et voilà le jeune diplômé engoncé dans un costume d’ingénieur électricien, lui qui rêve d’expérimentations et de recherches alambiquées.
La révolution du silicium
Après trois ans, il reçoit un appel qui va changer sa vie. A l’autre bout du fil, William Shockley. Co-inventeur du transistor, lui aussi récompensé par le Nobel, il vient de monter son propre laboratoire à Mountain View (qui jouxte Palo Alto) et propose à Noyce de le rejoindre. Le physicien de 28 ans n’hésite pas longtemps et saute sur l’occasion de s’asseoir à la droite de Dieu. Là-bas, une armée de doctorants en blouse blanche fait chauffer du silicium à haute température. Ce semi-conducteur, c’est-à-dire un matériau qui n’est ni complètement conducteur d’électricité, ni tout à fait isolant, va précipiter le changement de nom de la vallée de Santa Clara. « La vallée du silicium », la Silicon Valley, est officiellement née (silicium se dit silicon en anglais) .
Aujourd’hui, dans un monde d’horizons logiciels sans cesse dépassés, à l’heure de l’intelligence artificielle, il est difficile d’imaginer que l’avenir, le monde dans lequel on vit, ait pu s’écrire en tripotant des éléments chimiques. Bien malgré lui, c’est Shockley qui va donner l’impulsion décisive. L’homme est un génie à l’aura magnétique, mais c’est aussi un manager tyrannique et paranoïaque. La start-up est un véritable panoptique, à l’intérieur duquel les employés, dont le salaire est indiqué sur un tableau, sont invités à s’évaluer entre eux. Un jour, convaincu qu’un de ses disciples œuvre au sabotage de son grand projet, Shockley impose… un détecteur de mensonges.
Avant qu’il ne vire complètement raciste et eugéniste (puisque tel sera son triste destin), sept de ses ouailles décident de se mutiner dès 1957, et montent un cabinet new-yorkais pour lever des fonds afin de financer une nouvelle aventure. Les renégats y parviennent, mais l’argentier providentiel impose une condition : il réclame un nouveau capitaine, un leader charismatique, ce qui deviendra une condition pour exister dans l’univers ultra concurrentiel de la Silicon Valley. Robert Noyce, qui n’avait pas encore quitté le navire de Shockley, se laisse convaincre. Trente-six ans plus tard, dans son dernier article pour Esquire (The Tinkerings of Robert Noyce, décembre 1983), Tom Wolfe, le pape du nouveau journalisme narratif américain, verra toute l’importance de cette trahison originelle, qui allait nourrir l’« esprit start-up » : « Ce jour-là est né le concept qui ferait de l’industrie des semi-conducteurs un milieu aussi sauvage que le show business : la défection. »

Les “huit traîtres” prennent leur envol
Les « huit traîtres », tels que les nomme Shockley, s’associent à une entreprise new-yorkaise, Fairchild Camera and Instrument, pour créer une filiale californienne, Fairchild Semiconductor. A l’époque, la Silicon Valley est plus connue pour ses vergers que pour ses laboratoires, et on ne recense qu’une poignée de pionniers : General Electric, IBM et Hewlett-Packard, ces deux derniers travaillant sur ce que Wolfe nomme « un nouvel appareil hautement ésotérique et colossalement coûteux » : l’ordinateur.
Comme elle le fera plus tard avec Google et bien d’autres, l’université voisine de Stanford incite ses étudiants à se lancer dans le grand bain de l’entrepreneuriat. Si l’industrie des semi-conducteurs est alors la plus perfectionnée du monde, elle est aussi incroyablement artisanale. Tout est assemblé à la main. Tom Wolfe en fait une description éclatante de pénibilité : « Les postes de travail, où les transistors sont produits, ressemblent à des versions ensoleillées des ateliers de confection de Chinatown à San Francisco. Ici se tiennent des rangées de femmes penchées sur leur bureau, plissant les yeux sur leur microscope, accomplissant la plus fastidieuse et la plus frustrante des tâches manuelles, coupant des couches de silicium, prélevant de petits rectangles à l’aide de pinces à épiler, essayant d’y attacher des fils, les faisant tomber, fouillant le sol pour les ramasser, jurant, marmonnant, remontant sur leur chaise, frottant leurs yeux, leurs yeux plissés sur leur microscope, jusqu’à en devenir dingues. »
Mais les ingénieurs de Fairchild ont pour eux le sens du timing. Comme l’écrit le journaliste Fabien Benoit dans The Valley. Une histoire politique de la Silicon Valley (éd. Les Arènes, 2019) « ils sont les bonnes personnes au bon endroit. Nous sommes en 1957. Les Etats-Unis entrent dans la guerre froide. La demande de transistors s’envole et, trois jours seulement avant la création de Fairchild, les Soviétiques réussissent le lancement du satellite Spoutnik. La course est lancée. Les programmes spatiaux et militaires réclament des ordinateurs et des transistors. […] Le “triangle de fer” est en place. Université, entreprises, Etat. » Avec Noyce à la manœuvre, évidemment.
Le circuit intégré, la clé du succès
Dans l’affrontement entre blocs, la miniaturisation devient un enjeu national. Le premier ordinateur entièrement électronique, l’Eniac, construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est un monstre de 30 mètres de long sur 2,5 de haut et 0,9 de large, qui génère tellement de chaleur qu’il fait 120 degrés dans la pièce où il turbine. Il faut le rétrécir, et vite. En 1959, une nouvelle invention décisive précipite le virage vers l’infiniment petit. A six mois d’écart, deux ingénieurs inventent le circuit intégré, ce qu’on appelle plus communément la puce électronique : plusieurs composants rassemblés sur une petite plaque « de la taille d’une carte à jouer », selon les mots de Wolfe.
Le premier, Jack Kilby, travaille chez Texas Instruments à Dallas, et met au point sa trouvaille avec du germanium, un élément chimique déjà utilisé dans l’industrie ; le second s’appelle bien sûr Robert Noyce. Son circuit en silicium est plus efficace, moins coûteux. Une fois encore, l’homme du Midwest n’est pas le premier, mais celui qui remporte la mise. Finis, les câbles volages et les fils rebelles, le futur s’écrit sur des puces. Fairchild enchaîne les contrats, équipe les missiles Minuteman de l’armée. Pour les ordinateurs de bord du programme Gemini, le premier programme spatial informatisé (entre 1961 et 1966), la Nasa se sert des puces de Noyce.
En l’espace de dix ans, Fairchild devient une entreprise de douze mille salariés, et Noyce doit apprendre à faire mieux que son ex-mentor Shockley. Il a une obsession : ne pas reproduire la culture d’entreprise quasi féodale de la côte Est, sa hiérarchie sociale, ses comités exécutifs et ses codes vestimentaires rigides. Chez lui, le premier arrivé est le premier servi, du parking au rayon des idées. L’autonomie est presque totale. Les salariés sont embauchés dès leur sortie de l’université et tous sont tournés vers un seul objectif : une transcendance commune.
Les prémices de la culture start-up
Plus que des hippies d’entreprise, ce sont des bourreaux de travail qui sortent peu et divorcent beaucoup. Ils sont programmés pour manger, boire et dormir Fairchild. De son éducation du Midwest, Noyce a gardé une intime conviction : afin d’accomplir sa mission, il ne peut tolérer la présence de syndicats. Pour s’en prémunir, il faut transformer l’entreprise en famille, le lieu de travail en maison. Aujourd’hui encore, ce modèle est la norme inscrite au frontispice de la culture start-up, avec bras de chemise et tutoiement facile, le burn-out en embuscade.
Noyce poussera le curseur encore un peu plus loin chez Intel, qu’il cofonde avec Gordon Moore et Andrew Grove en 1968. Là-bas, il invente la carte mémoire et l’open space. L’un de ses disciples, Ted Hoff, met au point le premier microprocesseur, qui va permettre de créer des ordinateurs portables. Le « cool » californien s’accompagne de séminaires d’entreprise destinés à affermir la culture maison, celle de l’initiative et de l’auto-discipline. Noyce n’est pas seulement la figure centrale d’une révolution industrielle, c’est aussi l’âme – parfois damnée – de la Silicon Valley à venir, diaboliquement messianique.
En 2019, les nabis de la technologie continuent de psalmodier les mêmes homélies futuristes, comme si leurs entreprises étaient surtout des horizons spirituels. C’est toute l’ironie de la trajectoire de Noyce. Dans sa biographie de l’inventeur récidiviste (1), l’historienne Leslie Berlin rappelle qu’en avançant dans sa vie il a abjuré sa foi. « Ce qui le tracassait le plus avec les organisations religieuses, c’est que les gens ne pensent pas, dans les églises », écrit-elle. A de nombreux égards, il a pourtant reconstruit la congrégation de son enfance sous les abricotiers du comté de Santa Clara. Et si c’était ça, finalement, la Silicon Valley selon Robert Noyce : un culte dont les adeptes pensent trop vite ?
Updated/maj. 28-08-2019
Views: 1